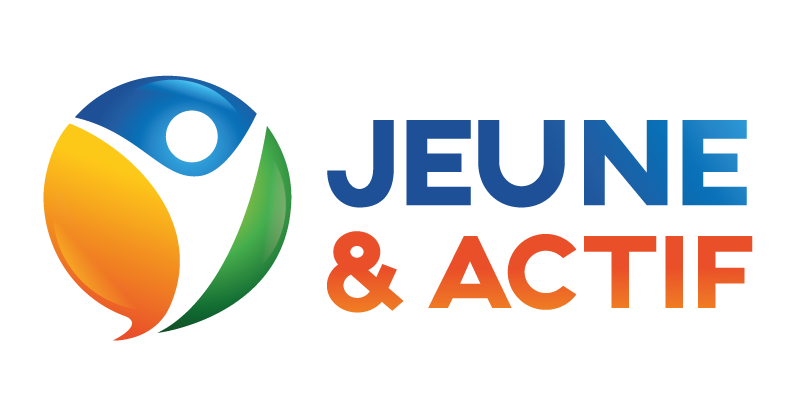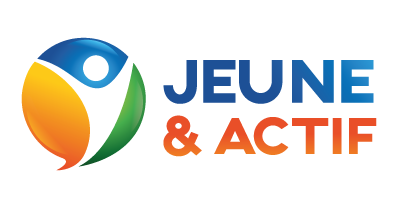Seul le Parlement détient, en droit français, la capacité d’instaurer la loi martiale. Aucun décret présidentiel ni décision gouvernementale ne peut suffire, même en cas de crise majeure. Cette règle s’inscrit dans une architecture juridique où l’exécutif dispose pourtant de larges prérogatives en matière de sécurité.
L’état de siège, souvent confondu avec la loi martiale, relève quant à lui d’une procédure distincte et codifiée depuis 1849. Les textes actuels ne prévoient aucune possibilité de suspension totale des libertés civiles au profit de l’autorité militaire, contrairement à d’autres systèmes juridiques.
Définition et origines de la loi martiale : comprendre un concept d’exception
Quand la loi martiale surgit, elle signe un bouleversement extrême : l’armée se substitue à l’autorité civile, appelée à la rescousse dans les situations où l’ordre public menace de s’effondrer. Ce principe, directement hérité du martial law britannique et injecté dans l’histoire française dès la Révolution, repose sur une inspiration venue d’outre-Manche : la fameuse loi de 1789, très inspirée du Riot Act d’Angleterre. L’objectif : juguler l’émeute, forcer le retour à l’ordre lorsque toutes les digues institutionnelles ont cédé.
Ce recours ne s’est jamais fait sans bruit. La fusillade du Champ-de-Mars en 1791, la Commune de Paris, les deux guerres mondiales ou encore la guerre d’Algérie en portent la marque : à chaque épisode, l’armée prend la main sur ce qui restait du pouvoir civil, dessaisissant les institutions ordinaires, repoussant les libertés le temps d’éteindre la crise. Les tribunaux militaires s’arrogent, dans la foulée, le pouvoir de juger sans attendre.
Basculer dans la loi martiale, c’est bien plus qu’un simple changement de gestion. Ce régime réserve tout l’espace public à l’autorité militaire, l’administration civile passant au second plan, jusqu’à disparaître. On ne confond pas ce basculement avec un état d’urgence ou un état de siège, même si, dans le feu des crises, les frontières se sont parfois brouillées en France. D’autres pays, le Royaume-Uni bien sûr, mais aussi la Corée du Sud ou le Canada, ont, eux aussi, utilisé le glaive de la loi martiale lors des épisodes les plus périlleux. Dans notre pays, ce dispositif reste dans la mémoire collective l’incarnation du recours extrême, activé seulement lorsque la République vacille et que l’équilibre républicain exige le passage de flambeau à l’armée.
Qui détient le pouvoir de déclarer la loi martiale en France et dans le monde ?
Aujourd’hui, la proclamation de la loi martiale n’existe plus vraiment dans l’arsenal constitutionnel français. Depuis la Constitution de 1958, ce levier a disparu, remplacé par une notion cousine : l’état de siège, prévu par l’article 36. Le gouvernement conserve la main pour établir un état de siège, mais dès que la mesure franchit douze jours, elle tombe dans l’escarcelle du Parlement. Cette répartition entérine une volonté de surveillance démocratique constante, surtout lors des moments les plus tendus.
La France a donc opté pour une voie où l’exécutif ne dispose jamais longtemps d’un pouvoir d’exception incontrôlé. À la différence de la loi martiale d’autrefois, qui laissait l’armée s’emparer de la totalité de l’espace public, l’état de siège actuel préserve, autant que possible, quelques piliers démocratiques. Il ne sera activé qu’en cas de guerre, d’invasion étrangère ou d’insurrection armée, autant de cas où la société est déjà ébranlée au plus profond.
Mais ce schéma n’est pas universel. La Corée du Sud a expérimenté la loi martiale en 2024 sur décision du président Yoon Suk-yeol, concentrant tous les leviers entre ses mains. Au Canada et au Royaume-Uni, c’est aussi le pouvoir exécutif qui mène la danse en période de crise. Les États-Unis, eux, fonctionnent en mosaïque : le président détient un pouvoir d’activation national, mais chaque État peut prendre sa propre voie, d’où la difficulté de dessiner une doctrine cohérente.
Pour mettre en lumière les différences de procédures selon les pays, voici un aperçu rapide :
- France : état de siège décrété par le gouvernement, sous contrôle parlementaire après douze jours.
- Corée du Sud : décision directe du président.
- Canada, Royaume-Uni : activation par l’exécutif gouvernemental.
- États-Unis : partage incertain entre le niveau fédéral et les gouverneurs des États.
La déclaration de la loi martiale révèle donc, derrière ses aspects spectaculaires, le rapport singulier de chaque démocratie à la séparation des pouvoirs entre élus et exécutif.
Loi martiale, état de siège, état d’urgence : quelles différences fondamentales ?
En France, la loi martiale appartient désormais à l’histoire, mais le terme continue de prêter à confusion. Il existe en réalité trois régimes d’exception, chacun obéissant à une logique propre. La loi martiale, directement issue du Riot Act britannique, confiait l’intégralité des pouvoirs à l’armée : la justice passait devant des tribunaux militaires, les libertés individuelles disparaissaient en bloc, tout cela dans le but de rétablir la sécurité sans entrave. On l’a vue à l’œuvre lors de la Révolution française, pendant la Commune de Paris, lors des deux conflits mondiaux et tout au long de la guerre d’Algérie.
Depuis 1958, l’état de siège détient le relais. C’est lui qui est cité dans la Constitution, article 36. Concrètement, lors d’un danger majeur, certains pouvoirs de police et de justice peuvent passer à l’armée, mais cette situation n’est que temporaire et reste encadrée par un contrôle parlementaire strict. La France n’a d’ailleurs jamais utilisé cet outil sous la Cinquième République.
L’état d’urgence a été instauré en 1955 avec une vocation bien différente : réagir à une menace immédiate contre l’ordre public. Ici, les préfectures voient leur autorité renforcée avec, par exemple, la faculté de limiter les déplacements, d’interdire les rassemblements ou de multiplier les contrôles. Mais il y a une limite infranchissable : l’administration civile conserve toujours la main, l’armée ne s’empare jamais du pouvoir réel. L’état d’urgence a été mobilisé lors d’événements récents comme la crise du Covid-19, jamais il n’a signifié la fin des droits devant des juges civils.
Pour démêler les spécificités de chaque régime, ce rappel synthétique s’impose :
- Loi martiale : tous les pouvoirs passent à l’armée, justice exclusivement militaire.
- État de siège : transfert temporaire de compétence, avec contrôle du Parlement.
- État d’urgence : extension des pouvoirs civils, jamais de domination militaire directe.
Quels impacts sur les droits et la vie quotidienne des citoyens ?
Basculer sous loi martiale ou en état de siège chamboule violemment la vie quotidienne. Les libertés individuelles deviennent soudain remises en cause : déplacements restreints, rassemblements supprimés, liberté de la presse sous étroite surveillance. Toutes les décisions échappent à la société civile, l’organisation militaire s’impose. On ne discute plus, on obéit : la logique disciplinaire éclipse presque toute contestation.
La justice civile, dans cet environnement, s’efface. Les tribunaux militaires traitent la plupart des dossiers, y compris les délits mineurs. La notion même de procès équitable s’étiole, les recours diminuent, la défense du citoyen se réduit à peau de chagrin. Le principe fondamental d’habeas corpus risque d’être suspendu, défaisant un équilibre chèrement acquis entre État et individu.
Pourtant, depuis la Seconde Guerre mondiale, une barrière subsiste : la Convention européenne des droits de l’homme et le droit international humanitaire limitent très clairement les possibilités de restriction, même lors d’événements exceptionnels. Des dérogations peuvent exister, mais le juge européen veille. La France se doit désormais, à chaque crise, de préserver la ligne de crête entre sauvegarde de la nation et maintien des droits fondamentaux.
Les mesures concrètes qui modifient la vie sous un tel régime sont les suivantes :
- Application d’un couvre-feu et limitation stricte des déplacements
- Interdiction ou encadrement sévère des rassemblements publics
- Censure de la presse et filtrage de l’information
- Procédures judiciaires dévolues à l’autorité militaire
Quand l’État de droit s’efface, chacun découvre la minceur du fil qui garantit ses propres libertés. L’histoire, elle, montre que rien n’est jamais acquis : la vigilance s’impose, même loin des sirènes de la crise.